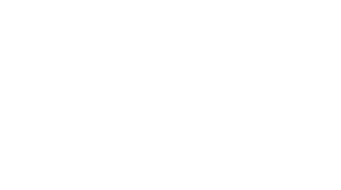Shereen Amos est directrice générale de Sugarbird Studios, une agence stratégique de création et de recherche qui mobilise l’action collaborative à travers des conférences, des documentaires de recherche, des plateformes d’engagement et des expériences conceptuelles immersives. Son travail l’a amenée à poursuivre un master en innovation inclusive (UCT) et une recherche doctorale sur l’innovation multi-acteurs dans les systèmes complexes.
Elle a soutenu sa thèse de Doctorate of Business Administration (DBA) en octobre 2025 avec une thèse intitulée “From Disruptive Innovation to Meta-Innovation: Reconceptualising and Directing Innovation at Scale” (en français : « De l’innovation disruptive à la méta-innovation : repenser et orienter l’innovation à grande échelle »), sous la direction du professeur Emmanuel Josserand, professeur à EMLV – École de Management Léonard de Vinci, France.
Cette thèse présente un cadre permettant d’orchestrer l’innovation au-delà des frontières technologiques, sociales et environnementales afin de relever les grands défis interconnectés.
Direction de thèse
Pr. Mothe Caroline, Pr. Josserand Emmanuel
Thèse de DBA
De l’innovation disruptive à la méta-innovation : repenser et orienter l’innovation à grande échelle
Résumé
Cette thèse étudie l’évolution de la théorie de l’innovation de rupture dans des contextes contemporains caractérisés par des changements technologiques sans précédent, une urgence environnementale et une transformation sociale. Depuis son introduction par Bower et Christensen (1995), la théorie de l’innovation de rupture a profondément façonné la manière dont les chercheurs, les praticiens et les décideurs politiques appréhendent la dynamique de l’innovation de rupture et l’évolution concurrentielle. Cependant, l’innovation se déployant de plus en plus par le biais d’accords collaboratifs complexes plutôt que par des actions isolées des entreprises, sa conceptualisation initiale se heurte à d’importantes limites explicatives.
Malgré l’influence durable de l’innovation de rupture, les contextes dans lesquels elle se déploie aujourd’hui ressemblent peu à ceux qui ont façonné la théorie initiale. Les technologies numériques ont brouillé les frontières sectorielles et permis l’émergence de modèles économiques basés sur des écosystèmes et des plateformes. Les impératifs environnementaux ont créé une demande de solutions qui préservent et régénèrent les systèmes naturels et sociotechniques. Si les chercheurs ont progressivement élargi la théorie de l’innovation de rupture pour répondre à ces changements, cette expansion s’est faite sans cadre théorique cohérent, créant un fossé important entre la théorie établie et les phénomènes d’innovation contemporains.
Cette thèse, à travers trois articles, développe une compréhension plus holistique de l’innovation de rupture en examinant comment le concept a été reconceptualisé pour les contextes contemporains, comment l’innovation disruptive se manifeste à travers différentes configurations aux caractéristiques distinctes, et comment les entrepreneurs pilotent intentionnellement l’émergence d’un écosystème d’innovation de rupture par des pratiques spécifiques. La recherche utilise des méthodes diverses dans ces trois articles : analyse bibliométrique et revue systématique pour retracer l’évolution de l’innovation de rupture ; analyse théorique pour développer un cadre configurationnel ; et recherche qualitative des processus à travers une étude de cas de Regen Farmers Mutual pour identifier les pratiques entrepreneuriales dans le développement de l’écosystème.
La recherche révèle comment l’innovation de rupture est passée d’un phénomène concurrentiel centré sur l’entreprise à une force multidimensionnelle de transformation de l’écosystème et de la société. Elle identifie trois configurations distinctes – dirigée par l’entreprise, écosystème d’innovation et système sociotechnique – à travers lesquelles l’innovation de rupture se manifeste dans différents contextes. Grâce au modèle de processus du travail écosystémique, elle met également en lumière sept micro-pratiques contribuant à six processus directeurs que les entrepreneurs déploient pour piloter l’émergence d’un écosystème d’innovation de rupture à travers les étapes de développement.
De la synthèse de ces trois articles émerge un nouveau concept théorique, la méta-innovation, qui représente une reconceptualisation fondamentale de la manière dont les processus d’innovation eux-mêmes peuvent être transformés pour relever des défis complexes couvrant simultanément plusieurs domaines. Ce concept émergent est précisément défini par des conditions nécessaires et suffisantes qui le distinguent des concepts d’innovation adjacents, avec un cadre pratique pour sa mise en œuvre. Le concept et la pratique de la méta-innovation offrent à la fois des avancées théoriques et des orientations pratiques pour relever des défis complexes et interconnectés. Les recherches futures pourraient examiner de manière productive la méta-innovation dans divers contextes, étudier les capacités et les approches de leadership qu’elle requiert, explorer l’évolution des dispositifs de gouvernance et développer des approches plus nuancées en matière d’évaluation et d’analyse d’impact.
Pour les dirigeants d’organisations et les entrepreneurs, cette thèse fournit des cadres pratiques pour naviguer dans des environnements d’innovation de plus en plus complexes, facilitant des décisions stratégiques quant au modèle d’innovation le mieux adapté aux défis et aux contextes spécifiques. Pour les investisseurs et les bailleurs de fonds, elle remet en question les logiques d’investissement conventionnelles en révélant la trajectoire de développement non linéaire de l’innovation contemporaine. Pour les décideurs politiques, elle met en évidence la manière dont les approches politiques doivent évoluer pour soutenir l’innovation à grande échelle, en développant de nouvelles mesures qui capturent les impacts au niveau de l’écosystème et la création de valeur multidimensionnelle.