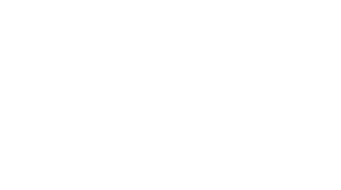Titulaire d’un master en business administration, Valérie Monnin a débuté sa carrière dans le controlling au sein de l’industrie horlogère avant d’ orienter son parcours vers marketing dans le secteur alimentaire. Elle est actuellement responsable des relations avec la grande distribution pour une organisation active dans l’agriculture biologique et s’occupe des stratégies de positionnement et de différenciation.
Elle a soutenu en mars 2025 son Executive Doctorate of Business Administration (EDBA), sur le thème « Au-delà du “bio” : la recherche de cohérence interne comme moteur de différenciation des transformateurs bio – Le cas de la Suisse» sous la direction de Professeur Michelle Bergadaà, professeur émérite de l’Université de Genève. Ses recherches explorent comment les transformateurs agro-alimentaires bio peuvent maintenir leur cohérence face aux mutations du marché, avec un accent particulier sur l’influence de la personnalité des dirigeants dans ce processus d’adaptation.
Direction de thèse
Pr. Bergadaà Michelle
Thèse de DBA
Au-delà du “Bio” : La recherche de cohérence interne comme moteur de différenciation des transformateurs bio – Le cas de la Suisse
Résumé
La Suisse, pionnière en agriculture biologique, présente la plus haute consommation bio par habitant en Europe, fruit d’une histoire riche et de l’engagement précoce des grands distributeurs. Dans ce contexte, cette recherche examine les entreprises de transformation de produits biologiques qui jouent un rôle essentiel en assurant le lien entre production et consommation. Malgré leur importance dans la chaîne de valeur, ces acteurs restent peu explorés dans la littérature scientifique, laissant des lacunes concernant leurs spécificités organisationnelles et managériales. Ces entreprises sont aujourd’hui confrontées à un défi majeur : maintenir leur différenciation dans un marché où le bio se démocratise et où les pratiques durables deviennent progressivement la norme.
La problématique centrale interroge les facteurs de cohérence permettant une segmentation pertinente des transformateurs bio, afin de développer des recommandations adaptées à chaque profil d’entreprise pour assurer leur pérennité dans cet environnement en mutation.
Les contributions de cette recherche sont doubles : d’une part, sur le plan théorique, elle enrichit les modèles communautaires de Bergadaà (2006) en les adaptant au contexte des transformateurs bio, tout en mobilisant les concepts d’« identités multiples » (Lahire, 2012) et de responsabilité organisationnelle (Carroll, 1979) ; d’autre part, sur le plan pratique, elle propose des recommandations stratégiques concrètes pour aider les dirigeants à se positionner efficacement dans un marché en évolution constante.
L’originalité de cette recherche repose sur l’inversion du paradigme traditionnel d’analyse organisationnelle en plaçant l’identité du dirigeant comme point focal pour comprendre les dynamiques entrepreneuriales. La méthodologie, qualitative et inductive, s’appuie sur la vision encastrée de l’entreprise (Polanyi, 1944) et mobilise la théorie éthique des parties prenantes (Freeman, 1997). L’étude s’appuie sur douze entretiens semi-directifs menés auprès de dirigeants d’entreprises de transformation bio, analysés par une combinaison d’approches thématique et structurelle.
La recherche identifie trois construits communautaires structurant le secteur : la communauté d’enracinement (le bio comme fondement historique de l’entreprise, avec une identité protective), la communauté de destin (le bio intégré dans une vision multidimensionnelle de la durabilité), et le réseau d’opportunité (le bio comme marché à exploiter). L’analyse révèle quatre groupes de déterminants-clés (raison d’être, racines collectives, organisation et responsabilité) qui façonnent les approches dans les dimensions sociétale, environnementale, managériale et commerciale.
Le modèle théorique final propose que l’équilibre dynamique entre trois dimensions fondamentales — l’identité du dirigeant, l’appartenance communautaire et le modèle économique — constitue un facteur déterminant pour la cohérence interne et la pérennité des transformateurs bio. Cette recherche recommande un processus en trois étapes (reconnaissance, construction, renforcement) permettant aux entreprises d’identifier leur positionnement communautaire et de le redéfinir en cohérence avec l’identité du dirigeant.
Les entreprises de type “communauté de destin” apparaissent particulièrement bien positionnées pour répondre aux attentes des nouvelles générations, suggérant leur rôle potentiellement transformatif dans l’évolution du secteur vers une responsabilité sociétale authentique et éthique.
Dans un environnement où les attentes sociétales évoluent rapidement, cette cohérence entre identité du dirigeant, appartenance communautaire et modèle économique devient un moteur de différenciation crucial, permettant aux transformateurs bio de maintenir leur singularité tout en s’adaptant aux défis contemporains.