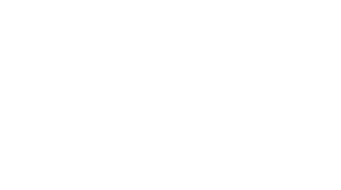Ingénieur en Statistiques depuis 2005 et titulaire d’un Master en Management et d’un MBA International de l’Université́ Paris Dauphine-Panthéon Sorbonne, Mamadou Ndao a débuté sa carrière professionnelle dans le suivi et l’évaluation des programmes de développement et des politiques publiques.
Il est actuellement Directeur général de l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes du Sénégal. Avant d’occuper ce poste, Monsieur NDAO a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de projets et programmes de développement financés par l’Union Européenne, l’USAID et le MCC. De 2012 à 2022, il a occupé le poste de Directeur Suivi Évaluation de l’AGEROUTE. En novembre 2022, Monsieur Mamadou NDAO est nommé Secrétaire Général de l’AGEROUTE, poste qu’il occupe jusqu’au 27 décembre 2023, date à laquelle, il est promu Directeur Général de l’AGEROUTE.
Il a soutenu en octobre 2025 son Executive Doctorate of Business Administration (EDBA), sur le thème « la montée en puissance de la Chine en Afrique et le financement des infrastructures : le cas du Sénégal » sous la direction de Professeur Pierre-Jean Benghozi, Professeur au CNRS- Ecole polytechnique Paris, France.
Cette thèse a pour objectif principal l’étude de la problématique du recours aux financements extérieurs en mettant l’accent sur la montée en puissance de la Chine en Afrique dans le financement et la réalisation de programme d’infrastructures, particulièrement au Sénégal, ainsi que les conditions et les modalités de ces financements, et leurs implications sur le développement socioéconomique.
Direction de thèse
Pr. Benghozi Pierre-Jean
Thèse de DBA
La montée en puissance de la Chine en Afrique et le financement des infrastructures : le cas du Sénégal
Résumé
Les infrastructures jouent un rôle essentiel dans la promotion de la croissance économique à travers l’amélioration de la productivité et de la compétitivité, la réduction de la pauvreté, l’accès des personnes et des organisations aux nouvelles TIC et la contribution à la durabilité environnementale (Fabre et Straub, 2019 ; Alano et al. 2018 ; Calderón et Servén, 2010 ; Estache et Vagliasindi, 2007). S’agissant de l’Afrique subsaharienne, la croissance démographique et l’urbanisation rapide exercent une pression énorme sur les infrastructures existantes et font que les gouvernements font face à des défis de taille dans ce domaine.
« La nécessité croissante de développer les infrastructures en vue de satisfaire les besoins pressants et croissants en infrastructures des populations et les contraintes budgétaires que connaissent les pays africains ont amené les gouvernements à recourir aux financements extérieurs mais également les IDE ».
La présente thèse a pour objectif principal l’étude de la problématique du recours aux financements extérieurs en mettant l’accent sur la montée en puissance de la Chine en Afrique dans le financement et la réalisation de programme d’infrastructures, particulièrement au Sénégal, ainsi que les conditions et les modalités de ces financements, et leurs implications sur le développement socioéconomique. La Thèse a permis de passer en revue une vaste littérature sur les courants de pensée et les théories pour aboutir au choix d’une méthodologie robuste. Une méthodologie qui combine à la fois l’analyse descriptive et l’analyse économétrique.
Les résultats de nos analyses confirment la montée en puissance de la Chine en Afrique subsaharienne puisque la Chine est devenue le premier partenaire financier dans le domaine des infrastructures (transport, énergie, eau et assainissement), avec 62 % des parts en 2022 grâce à sa stratégie « Go Out Policy ». Ils révèlent que la dynamique chinoise en Afrique subsaharienne repose principalement sur l’utilisation d’instruments financiers tels que les prêts concessionnels (des taux d’intérêts compétitifs, des périodes de remboursement flexibles), le renforcement des relations diplomatiques et une plus grande implication des Policy Banks chinoises (Eximbank, CBD, etc.). S’agissant des résultats de l’analyse économétrique portant spécifiquement sur le cas de la CEDEAO, il en ressort que l’indice d’infrastructure calculé à partir d’autres sous-indices des secteurs des TIC, de l’Energie et du Transport, impacte positivement et significativement le PIB par habitant des pays de ladite zone.